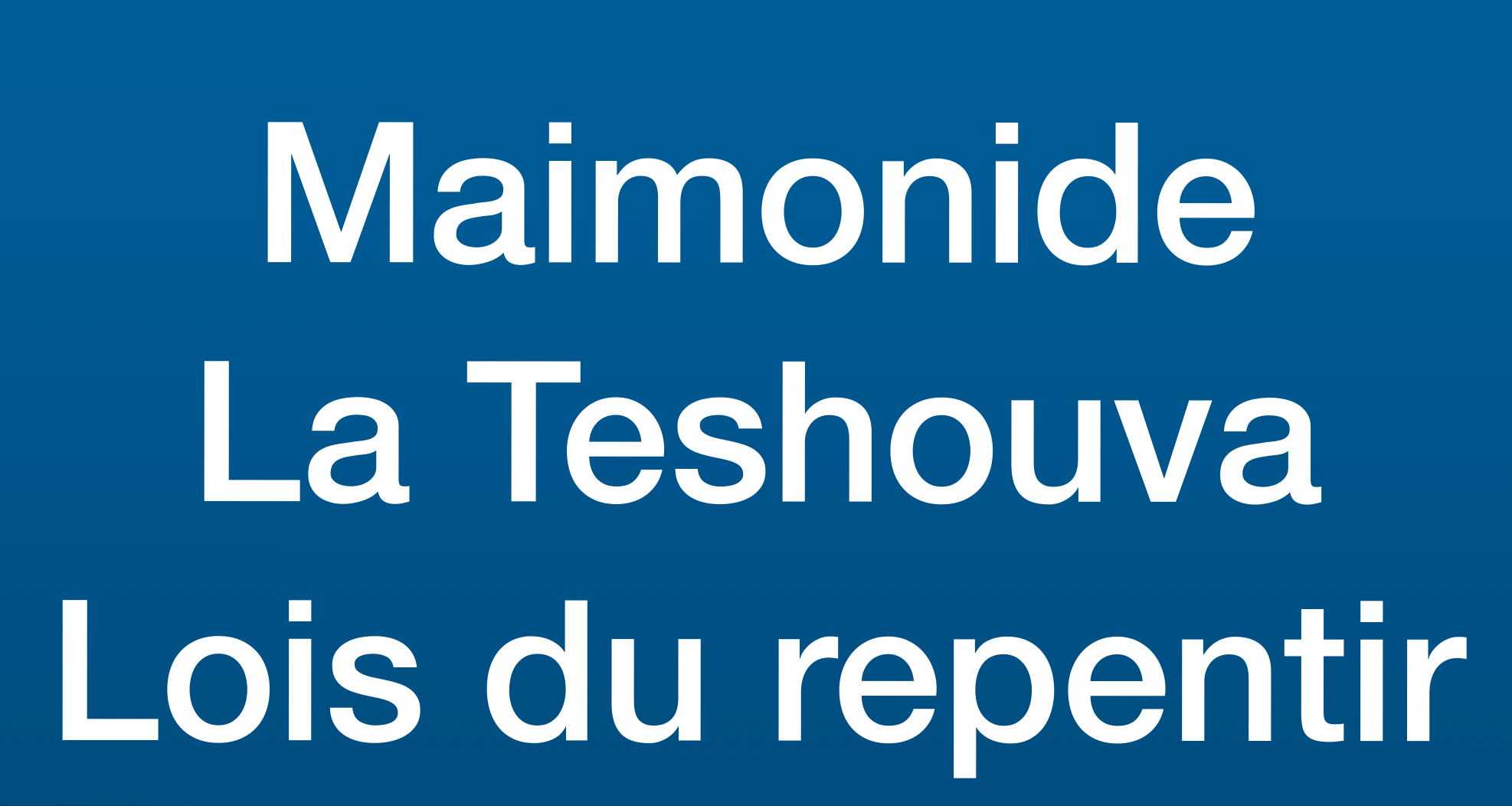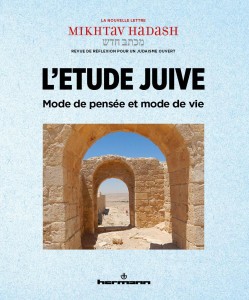L’historien Yosef Hayim Yerushalmi est mort mardi 8 décembre dans sa ville natale de New York. Il y enseignait à l’université Columbia, où il occupait la chaire qui portait le nom de son directeur de thèse, le professeur Salo Wittmayer Baron (1895-1989). Yosef Yerushalmi aimait à souligner que Baron avait été le premier à enseigner cette discipline académique récente, l’histoire juive, dans une université occidentale en 1930.
Originaire de Goloskov (Ukraine), le père de Yerushalmi (en hébreu "de Jérusalem") avait résidé dans la Palestine mandataire avant de gagner New York, où il rencontra sa femme. Dans sa jeunesse, le futur historien fréquente des mouvements halouzik (sionistes). Tout en considérant que l’histoire juive concerne tout lieu et tout temps, où l’on peut trouver des juifs, il estimera qu’Israël occupe une place centrale dans le monde juif d’aujourd’hui.
Baignant dans un milieu polyglotte (il apprend l’hébreu avant l’anglais, et parle yiddish avec sa mère), et attaché au judaïsme sans être orthodoxe , le jeune Yerushalmi reçoit une éducation juive approfondie dans des yeshivot (écoles religieuses juives) new-yorkaises. Il est tenté par des études de droit, mais sa vocation d’"historien juif" le rattrape dans ses premières années d’études. Après avoir été assistant-professeur à Harvard, où il préside le département des langues et des civilisations du Proche-Orient, il retourne, en 1980, à Columbia, où se déroulera sa carrière.
Yosef Yerushalmi a consacré le gros de son travail à l’étude du judaïsme séfarade et des marranes, ces juifs convertis au catholicisme mais qui continuaient à pratiquer secrètement leur ancienne religion. Son travail de doctorat, publié pour la première fois en 1971, eut ainsi pour thème la vie d’un de ces personnages du XVIIe siècle espagnol, Isaac Cardoso (traduit en français sous le titre De la cour d’Espagne au ghetto italien, Fayard, 1987). Dans une reconstitution tenant à la fois de l’érudition et du roman policier, il s’était attaché à retracer le destin de ce philosophe et médecin, coqueluche des Grands d’Espagne, que le spectacle des autodafés et la pression de l’Inquisition poussèrent à l’exil, en 1648.
Si Yerushalmi faisait des marranes sa spécialité, il se voulait pourtant "historien des juifs" à part entière. De fait, la dualité dans laquelle les conversos étaient contraints de vivre leur foi dans la péninsule Ibérique n’était pas, à le lire, sans rapport ni continuité avec la condition juive moderne, qu’elle pouvait éclairer.
Les juifs contemporains ne se rattachent-ils pas, eux aussi, à la mémoire d’une tradition dont ils se trouvent séparés sans retour ? Dans un tel contexte, l’histoire devient le seul lien possible avec une identité juive dont Yerushalmi estimait par ailleurs qu’elle était devenue objet de choix et non plus héritage. Ces réflexions pionnières sur la relation au passé donneront lieu à son essai le plus commenté, Zakhor : Histoire juive et mémoire juive, traduit et publié par son ami et éditeur Eric Vigne (La Découverte, 1984, puis Gallimard, "Tel"). Non seulement ce retour sur l’historiographie a fait école auprès des historiens juifs de la génération suivante, comme l’Américain David Myers ou l’Allemand Michael Brenner ; mais elle est venue nourrir les débats sur la mémoire qui dominent la scène intellectuelle dans les années 1980 et 1990.
Regard scientifique
En France, en particulier, la réception du travail de Yerushalmi va bien au-delà de sa discipline d’origine. Certains veulent faire du marranisme le symbole de l’identité plurielle de l’époque actuelle. D’autres, comme l’historienne Sylvie-Anne Golberg, ont inscrit leur travail dans son sillage. D’autres encore, comme le politologue Pierre Birnbaum, qui consacre un chapitre de sa Géographie de l’espoir (Gallimard, 2004) à Yosef Yerushalmi, le font figurer aux côtés d’Emile Durkheim (1858-1917) et de Raymond Aron (1905-1983).
Soucieux d’étendre ses investigations à toute une matière dont il reconnaissait par ailleurs qu’il était désormais impossible de rendre compte exhaustivement comme l’avaient fait ses prédécesseurs, Yerushalmi s’était attelé, en 1991, à une relecture du Moïse dû au père de la psychanalyse (Le Moïse de Freud. Judaïsme terminable et interminable, Gallimard, 1992). Pour la première fois, un historien confirmé du judaïsme tentait une évaluation sérieuse d’un texte hautement problématique, lançant du même coup un débat international, autour de la figure de Moïse, qui se prolonge encore. Tout en montrant par certains indices les attaches complexes (marranes ?) de Freud avec la tradition juive, Yerushalmi entendait pointer, par contraste, ce qu’il y avait de vieilli dans l’idée que Freud se faisait du judaïsme (se cristallisant autour d’une mémoire tribale du prétendu meurtre de Moïse) - là encore à mille lieues de l’identité par choix.
Ce livre avait donné l’occasion au philosophe Jacques Derrida de répondre par son Mal d’archive (Galilée, 1995). Il reprocha sur un ton courtois à Yosef Yerushalmi le positivisme de sa méthode et son projet de vouloir à nouveau "circoncire" Freud sans tenir compte du mécanisme de refoulement. Tous deux se retrouveront dans la défense de Freud quand la psychanalyse affrontera ses détracteurs américains, à la fin de la dernière décennie du XXe siècle.
La politique menée par les communautés juives à travers les âges constitua un autre axe, à la fois fort et dérangeant, de son regard scientifique sur le passé juif. L’occasion en fut fournie par la relecture du Sceptre de Judah, un récit historique des tribulations juives rédigé par un exilé espagnol du XVIe siècle réfugié au Portugal, Salomon Ibn Verga (Sefardica, "Le Massacre de Lisbonne en 1506", Chandeigne, 1998). Cette analyse devait se prolonger par une méditation critique de grande ampleur sur la tendance des responsables juifs à trop se fier en l’"Alliance royale". Autrement dit, à croire en la protection des rois et des Grands contre un peuple considéré comme a priori hostile. Seul l’"abandon des juifs", victimes, au cours du dernier conflit mondial, d’un Etat assassin aurait fini par ébranler cette confiance séculaire que l’expulsion d’Espagne en 1492 avait à peine entamée et que symbolisait l’expression répandue de "serviteurs des rois et non serviteurs des serviteurs" (titre d’un article important traduit dans la revue Raisons politiques, n° 7, 2002).
Cette confiance médiévale s’arrimait du reste à une réalité incontestable pour l’historien. Celle d’une chrétienté ayant certes beaucoup persécuté les juifs, mais également permis au judaïsme de survivre "comme une religio licita, tant aux yeux de l’Etat que de l’Eglise", au lieu d’être extirpée et détruite comme une hérésie...
L’historien qu’il était s’empêchait de chercher à jouer au prophète comme au nostalgique. Pas question d’apprendre de lui si, dans les conditions créées par la modernité, le judaïsme avait plus ou moins de chances de subsister qu’au Moyen Age. Toutefois, dans une conférence donnée en 1986 au colloque des intellectuels juifs de langue française ("Un champ à Anathoth", dans Mémoire et histoire, Denoël), Yosef Yerushalmi en appela, contre l’obsession de la destruction et de la mort, à la constitution d’une "histoire de l’espoir juif".
Certes, une telle histoire éloignerait du monde de "nos pères". Mais, ajoutait-il, "distance n’est pas vacuité".
Nicolas Weill dans Le Monde